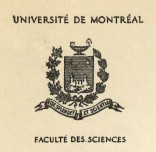
Sciences & modernité :
la petite faculté de luxe
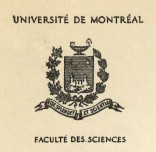 |
Sciences & modernité : |
Au cours du XIXe siècle, plusieurs pays industrialisés tels l'Allemagne, la France et les États-Unis, adoptent l'idée d'une université moderne et de l'institutionnalisation de la science. Le Québec, avec quelques décennies de retard, a lui aussi emprunté cette route. Plusieurs voix se sont élevées durant le dernier quart du XIXe siècle, réclamant un enseignement scientifique et technique qui aurait permis aux Canadiens français de se tailler une place dans les ministères provinciaux ou fédéraux, dans les laboratoires privés et dans la grande industrie. Or, ce n'est qu'avec la Première Guerre mondiale que plusieurs membres de la collectivité canadienne-française ont pris conscience de leurs lacunes au niveau scientifique. Afin de combler ce retard, une certaine élite scientifique et universitaire a investi ses énergies à la conception de ce qu'Édouard Montpetit a appelé "une grande université, une université moderne".
La Faculté des sciences de l'Université de Montréal est créée afin de devenir l'un des moteurs du rattrapage scientifique et économique du Canada français. Cette volonté des dirigeants est tellement importante que la devise de l’institution devient "Fide splendet et scientia" qui se traduit par "elle rayonne par la foi et la science". Pour justifier ce choix, Monseigneur Olivier Maurault disait: "comme toute devise, celle de l’Université de Montréal est un souhait, l’expression d’un idéal. Elle implique l’idée de progrès".
La période 1920-1945, les historiens des sciences en conviennent, correspond aux années où ont été mises en place les bases qui allaient permettre le futur développement des sciences au Québec. La création de la Faculté des sciences s'inscrit donc dans l'ère des fondations de la "modernité scientifique" et les progrès actuels en sont la suite logique.
Or, les idéaux qui ont nourri la création de la Faculté des sciences ne se réaliseront pas sans peine. Durant ses premières années d'activités, celle-ci se voit même attribuer le surnom de "petite Faculté de luxe" par le public et par certaines facultés de l'Université. Il faut avouer qu'en 1920, sur cinquante étudiants inscrits à la nouvelle Faculté, seulement dix ne se destinent pas à la médecine et c'est pour ces derniers que six sections sont maintenues (mathématiques, physique, chimie, botanique, zoologie et minéralogie). En 1922, le frère Marie-Victorin écrivait:
"La création d'une Faculté des sciences à l'Université de Montréal, qui avait paru à plus d'un une redoutable équipée, a déjà donné des résultats suffisants pour que l'on puisse ranger cette initiative parmi les plus fécondes de la génération présente. Et, certes, la postérité ne devra pas oublier les courageux qui eurent la témérité de concevoir cette innovation, et les généreux qui firent les sacrifices que l'on sait pour la réaliser".
Ces "courageux" et ces "généreux", sont des individus qui, en dépit des épreuves traversées, ont consacré leur vie à l'édification et à la diffusion de la science. Le but de cette exposition est de rendre un témoignage de reconnaissance à ces pionniers, dont certains sont moins connus aujourd'hui. Elle veut également montrer dans quelles conditions intellectuelles, matérielles et financières la science s’est développée. Par exemple, en 1928, la maquette de la construction du pavillon principal sur la montagne est présentée au public. L'espoir entretenu par cette réalisation, qui ne se concrétisera que quinze ans plus tard, est bien exprimée dans cette exposition par le frère Marie-Victorin. Enfin, elle vise à faire part des découvertes et des avancées de la science qui ont été réalisées dans, et hors des locaux de l’Université de Montréal par son corps professoral. Soulignons que, pour des raisons évidentes, l'attention a été portée aux personnes qui ont œuvré à l’Université de Montréal.
Nous n'avons pas fait état des progrès des sciences médicales et techniques même si elles ont été à l’origine du développement de la Faculté des sciences. Nous avons plutôt voulu parler de ceux qui ont été associés à cette Faculté parce qu’ils sont souvent oubliés au profit des deux autres. Pourtant, ils ont été importants. Nous avons plutôt retenu les noms d'individus qui sont reconnus par les historiens des sciences.
La Division des archives de l’Université de Montréal conserve plusieurs fonds d’archives d'individus ou d'organismes qui sont mentionnés dans l’exposition. Nous avons utilisé les documents qu’ils ont produits ou reçus, "sans lesquels il n’y a pas d’histoire véritable" (Fernand Braudel), puisqu’ils sont les meilleurs témoins de leur participation à cette aventure de la science.
Nous sommes conscients des limites de cette exposition à partir de notre hypothèse de départ. Nous saurions gré à ceux et celles qui le désirent, de nous signaler les omissions et les correctifs nécessaires "à la vraie vérité", la raison fondamentale de toute science historique.
Nous vous souhaitons une excellente visite.
| Création | Enseignement | Pédagogie | Recherche | Organisation matérielle |
| Pionniers | Promotion de la science | Conclusion | Sources | Conception et remerciements |