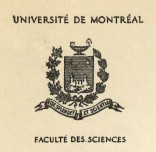
Sciences & modernité :
la petite faculté de luxe
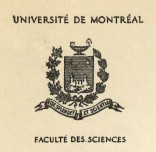 |
Sciences & modernité : |
Les vingt-cinq années suivant la création de la Faculté des sciences de l'Université de Montréal, en 1920, ont été semées d'embûches. Cependant, en dépit des épreuves traversées, l'Université de Montréal et sa Faculté des sciences connaissent une croissance lente mais significative. En ce qui concerne l'organisation de l'enseignement de la jeune Faculté, le modèle universitaire américain, basé sur le développement de la recherche, prend le pas sur le modèle français, davantage axé sur l'enseignement. Ainsi, au niveau de la recherche, plusieurs travaux sont réalisés au sein de la Faculté des sciences durant l'entre-deux guerre. Toutefois, force est de constater que la recherche ne prendra pas toute la place qui lui est due au cours de la période. Cette réalité résulte notamment du fait qu'à cette époque, l'Université connaît des difficultés matérielles et financières et que la société canadienne-française traverse une période des plus difficiles avec la Crise économique des années trente. Le gouvernement provincial a alors des priorités plus pressantes que l'essor des sciences et des études universitaires. Ce n'est qu'avec le déménagement de la Faculté des sciences dans l'immeuble du Mont-Royal, en 1943, que la recherche prend définitivement son envol.
Reproduction d'un tableau présentant le nombre de diplômes décernés par la Faculté des sciences entre 1921 et 1940 (Fonds de la Faculté des sciences E0096/C3,0008 Faculté des sciences).
Mais le contexte difficile n'empêche nullement nos "courageux" et "généreux" scientifiques de faire la promotion des sciences auprès de la population canadienne-française et de jeter les bases de ce que sera l'avenir scientifique du Québec. Jacques Rousseau dira même, au sujet de la Révolution tranquille: "En 1930 on semait, en 1960, on récoltait". Les problèmes reliés au financement de la recherche vont se poursuivre encore pendant quelques années.
Soulignons que le tragique décès du frère Marie-Vic- torin, en 1944, est une lourde perte pour le monde scientifique canadien-français et augure une période plus discrète pour les botanistes. Le mot de la fin pourrait justement revenir au frère Marie-Victorin: "Un peuple sans élite scientifique est, dans le monde présent, condamné, quelles que soient les barrières qu'il élèvera autour de ses frontières. Et le peuple qui possède ces élites vivra, quels que soient l'exiguïté de ses frontières et le nombre et la puissance de ses ennemis". Les efforts fournis par les pionniers de "la petite Faculté de luxe" entre 1920 et 1945, dans et hors des murs de l'Université, ont contribué à établir les bases du milieu scientifique québécois actuel. Il est essentiel de se le remémorer. |
 Marie-Victorin dans son cercueil, en juillet 1944 (1FP, 3122). |
| Présentation | Création | Enseignement | Pédagogie | Recherche |
| Organisation matérielle | Pionniers | Promotion de la science | Sources | Conception et remerciements |